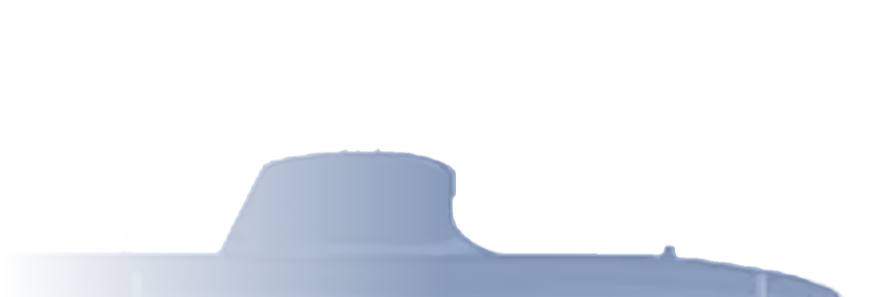Sous-marin S613 ROLAND MORILLOT (ex U-2518 de type XXI) de 1620 tonnes
Sous-marin S613 ROLAND MORILLOT (ex U-2518 de type XXI) de 1620 tonnes
Propos de Christian LECALARD (Ancien du sous-marin Roland Morillot du 01/01/1962 au 01/05/1965)
Membres de l'association qui ont embarqué sur le ROLAND MORILLOT
En ces temps où les rangs des Anciens du Roland MORILLOT s'éclaircissent et en mémoire de ceux qui nous ont quittés trop vite, ces quelques souvenirs qui replongerons les amis encore de ce monde, dans les entrailles si vivantes de notre vieux rafiot.
État des lieux
L'U 2518 du type XXI a été mis en service dans la marine Allemande le 4 novembre1944 et affecté à la 31ème flottille de sous marins basée à HORTEN dans le Fjord d'OSLO. C'est un sous marin océanique d'un déplacement de 1620 tonnes et d'une vitesse de pointe en plongée de 16 noeuds grce à 2 moteurs électriques de 2500 CV chacun. Deux diésels M.A.N lui assurait une vitesse en surface de 15,5 noeuds. Révolutionnaire pour l'époque. C'est là que les Anglais le capture en 1945. Il est prêté pour deux ans à la France en 1946 ou il arrive en remorque à CHERBOURG. Le 1er avril 1948, à la demande de la France, il est définitivement cédé à la marine Française et prend le nom de Roland MORILLOT S 613
Les torpilles
Le Roland MORILLOT pouvait embarquer 23 torpilles : - 16 sur rance, - 1 en cale - 6 aux tubes.
 Sous-marin S613 ROLAND MORILLOT - Le berceau en cale a été abandonné au profit d'une cambuse annexe permettant de stocker des légumes
Sous-marin S613 ROLAND MORILLOT - Le berceau en cale a été abandonné au profit d'une cambuse annexe permettant de stocker des légumesElles étaient de deux types :
- La torpille G7a en version T1 ou T3s pourvues d'un moteur à explosion alimenté par un mélange alcool (dékaline) et air comprimé. Ces torpilles pouvaient atteindre une vitesse de :
- 44 noeuds pour une portée de 6000 m.
- 40 noeuds pour une portée de 8000 m.
- 30 noeuds pour une portée de 14000 m.
- La torpille G7e en version T2 ou T3s, pourvues d'un moteur électrique alimenté par une batterie. Sa vitesse était de 30 noeuds pour une portée de 5000 m.
- Les versions T1 et T2 permettaient le paramétrage de l'immersion, de la vitesse, de l'azimut et de la gyrodéviation.
- La version T3s, en plus des paramètres de la T1, possédait le système LUT (LageUnabhängiger Torpedo), permettant un affichage des lacets longs ou courts. La torpille ou plutôt la gerbe de 3 torpilles était lancée sur la route moyenne du convoi. Les deux torpilles extérieures en lacets longs, la torpille centrale en lacets courts. Les éléments étaient affichés à partir du conjugateur qui se trouvait dans la partie haute du poste torpilles, entre les rances et les tubes lance-torpilles. La transmission des paramètre du conjugateur aux armes aux tubes, se faisait au moyen de tiges à cardans. À la mise au tube des torpilles, la manœuvre d'engagement des tiges de paramétrage avec les organes de l'arme, était très délicate. Pendant la période de 1962 à 1964, je crois que nous n'avons dû faire que deux lancements en gerbes avec lacets, car en exercice, il était difficile pour le commandant, de positionner le repêcheur par rapport à l'axe de lancement. Bien souvent la position de stoppage des torpilles n'avait rien à voir avec les prévisions et, les recherches s'éternisaient un peu.
Embarquement de torpilles
L'embarquement de torpilles était assez rapide avec des torpilleurs costauds, car les palans de manoeuvres étaient manuels et nous embarquions en moyenne, une quinzaine de torpilles. Les coques des torpilles étaient enrobées d'une copieuse couche de graisse et, lors de la manutention pour la mise sur rance il arrivait que la sangle en fer glisse, ce qui provoquait un mouvement de balancier dangereux pour les torpilleurs. Les torpilles étaient embarquées réservoir d'air vide. Il fallait donc procéder à la charge en air (140 l à 180 bars pour une G7a). Les postes de prise d'air pour le chargement à partir de flexible, permettaient d'alimenter 6 torpilles sur rances et 6 torpilles qui étaient rentrées de moitié dans les tubes. L'opération durait généralement toute la nuit pour deux périodes de charge, et mobilisait 2 torpilleurs et 2 mécaniciens qui se relayaient auprès des compresseurs JUNKERS. J'ai souvenir où nous avions en 1962 après la sortie de carénage et les essais, embarqués le stock de 22 torpilles de combat. Bien entendu avec cela, nous avions embarqué les mises de feu qui étaient munies chacune de quatre cornes de déclenchement au contact, mais il y avait des mises de feu avec un tube long et d'autres avec un tube court que nous vissions sur le cône de la torpille. La pyrotechnie avait semble-t-il oublié cette différence, ce qui fait que nous avions du procéder à l'essai d'amorçage de toutes les torpilles et échanger quelques mises de feu pour arriver à un résultat convenable.
Débarquement de torpilles
La manoeuvre inverse à l'embarquement comprenait la fastidieuse purge des réservoirs d'air, fastidieuse car les vannes de purge givraient très vite et, il fallait prévoir une bouilloire d'eau bien chaude à proximité pour de temps en temps procéder au dégivrage. L'atelier militaire des torpilles (AMT) nous voyait arriver à quai d'un mauvais œil, car souvent, pour les torpilles d'exercices, après avoir purgé les réservoirs, nous lancions en face de KIII, les 6 torpilles aux tubes. Les torpilleurs de l'atelier militaire des torpilles (AMT) remorquaient jusqu'à l'atelier annexe de KIII, les 6 torpilles. Gain de temps pour nous, pas très apprécié par nos amis de la base.
Lancement de torpilles
Le Roland MORILLOT pouvait lancer des torpilles jusqu'à une immersion de 30 mètres. Une performance pour l'époque de la mise en service des types XXI. Après 18 ans d'activités, les pièces étant un peu fatiguées. Des fuites apparaissaient ça et là . Aussi, lorsque nous procédions à un lancement à 30 mètres, une foule de curieux venaient au poste torpilles car dès la séquence d'équilibrage des tubes, l'ouverture des portes avant et le lancement des torpilles, des fuites d'eau apparaissaient sur la plupart des appendices des tubes : - portes culasses, - tiges de réglages de vitesse, d'immersion, d'azimut et LUT Les spectateurs pouvaient admirer les eaux de Versailles !
Rechargement rapide des torpilles
Il était écrit dans les spécifications allemandes, que la capacité de la cale pouvait contenir le volume des 6 tubes lance-torpilles, permettant en cas d'urgence la vidange rapide des tubes à la cale par ouverture des portes culasse. L'officier torpilleur avait pris la précaution de nous faire débarrasser la cale de la cambuse annexe après avoir proposé la manœuvre au pacha. Il avait été donc décidé de faire cette manoeuvre en immersion, à partir de la situation des tubes plein d'eau après lancement. 6 torpilles étant disposées aux postes de chargement. L'officier torpilleur, chrono en main est au poste torpilles. Les Torpilleurs servants des tubes, en tenues légères, prêts à déverrouiller les portes-culasses. Au top, ouverture des portes-culasses. Sachant bien que les portes avant sont bien fermées, les cascades d'eau sortant des tubes sont tout de même impressionnantes ! Effectivement, le niveau de l'eau dépasse légèrement le parquet et nous effectuons le rechargement en un temps record pendant que l'assèchement de la cale se fait. Il y avait quand même un hic à cette manœuvre menée de main de maître : C'est que les moteurs électriques de translations des berceaux des rances inférieures qui étaient à l'origine des moteurs hydrauliques, baignaient lamentablement sous trente centimètres d'eau dans la cale !
Navigation sur le Roland Morillot - Les veilleurs
À l'appareillage de Kéroman, nous savions que pour rejoindre les secteurs du golfe de Gascogne situés à la hauteur de BORDEAUX et sortir des fonds de 200 m, il fallait entre 10 et 12 heures de route selon le temps, plus souvent mauvais que bon. Nous nous attendions donc à recevoir de bonnes douches à la passerelle. Les parkas de l'époque n'étaient pas des modèles d'étanchéité, et il convenait de boucher au maximum les entrées d'eau. Pour cela, nous faisions avec beaucoup de soin l'inventaire du ballot de chiffons pour trouver des morceaux de vêtements avec un fort pouvoir absorbant, que nous mettions autour du cou et des poignets, avant d'enfiler le parka et prendre le quart à la passerelle.
 Photo Christian Lecalard
Photo Christian LecalardSous-marin S613 ROLAND MORILLOT - 1962 : Zanardo, Christian Lecalard
Les types XXI avaient la facheuse habitude de ne pas remonter à la lame, mais à la traverser. Les baignades étaient fréquentes pour l'équipe de quart. À partir d'une mer de force 3, il fallait déjà fermer le panneau supérieur, isolant ainsi l'officier de quart et les deux veilleurs, du reste du monde. A partir de mer 4 à 5, le harnachement était indispensable. C'était une tâche fastidieuse que de mettre cette large ceinture de cuir fermée par trois boucles et, deux fils d'acier terminés par des mousquetons que nous fixions à des appendices de la passerelle. Un jour où la mer commençait à se former, j'étais de veille, et nous avions fermé le panneau supérieur, car des gifles d'eau froide venaient rappeler la mauvaise humeur du golfe de Gascogne. Nous n'étions pas encore harnachés lorsqu'une première lame nous capelle un peu brutalement. Lorsque nous vîmes la seconde arriver haute comme une colline, l'officier de quart n'eut que le temps de crier «Accrochez-vous» et à la seconde suivante, j'étais à l'horizontale, accroché à une cornière voyant du vert partout, avec des secondes qui semblent des minutes en se demandant si le bateau va ressortir ! Le bateau sort enfin de l'eau. L'officier de quart se retourne pour voir si nous sommes encore là et fait réduire la vitesse. A l'interphone nous entendons la voix inquiète du maître de central qui demande si tout va bien, car le mano d'immersion a indiqué 18 mètres ! Nous ressemblons tous les trois à des «bibendums» les parkas remplis d'eau. Le pacha a finalement pitié de nous et ordonne à l'officier de quart de faire descendre l'équipe et prendre la veille au périscope dans le kiosque. Comble de malchance, mon copain a eu ses jumelles arrachées par le choc et doit subir l'interrogatoire suspicieux du patron du pont.
La prise de plongée
Ce type de sous-marin plongeait assez rapidement, et avait une flottabilité assez réduite. Dans le 1er temps de la prise de plongée, il est normalement prévu que le Maître de central fasse ouvrir les purges sauf les centraux, et attendre l'ordre d'immersion donné par l'officier de quart. Les consignes étaient un peu différentes, et l'officier ne déclenchait l'alerte qu'après avoir fermé le panneau supérieur, puis donnait l'ordre d'immersion. Certaines dispositions étaient prises par le barreur de direction, qui a la prise de tenue de veille mettait un parka. En effet, la barre de direction était dans kiosque, sous le panneau supérieur et ce dernier avait la fâcheuse habitude de fuir entre la surface et 10 mètres, douchant le barreur novice à qui on se gardait bien de faire part de cette particularité. Si le sous-marin restait à l'immersion périscopique, l'officier de quart mettait lui aussi une veste de parka pour protéger l'oculaire du périscope de veille d'une fuite continuelle du presse étoupe. La barre de plongée avant était rétractable et, n'était pas sortie au-dessus de 8 nœuds. Avant la prise de plongée, un veilleur se rendait au poste torpilles pour deux raisons : la première sortir la barre de plongée avant et la seconde surveiller la commande de purge du ballast 5, qu'il fallait souvent aider à ouvrir en appliquant un vigoureux coup de marteau sur le bras de la commande de secours. Il arriva qu'un jour où le veilleur allait signaler au central, la sortie de la barre de plongée avant, en se dirigeant vers le téléphone, il eut la peur de sa vie quand il vit le cône d'une torpille lui passer au ras de la tête, pour s'arrêter contre la porte culasse du tube lance-torpilles ! La fixation de la torpille au poste de chargement maintenue par les pales d'hélice, avait dérapée ! C'est d'une voix blanche qu'il rendit compte de la sortie de barre avant, de la fuite normale à la purge du 5 et de la position anormale d'une torpille. Deux décennies plus tard, étant maître de central du sous-marin nucléaire d'attaque RUBIS, je n'ai pu m'empêcher d'esquisser un sourire lorsque le rondier avant m'annonça avec inquiétude qu'il avait détecté une goutte d'eau perlant sur un sectionnement lors de la ronde d'étanchéité. Autres temps, autres mœurs.
Marche au schnorchel
C'était cela aussi, une grande particularité de ce type de bateau. Le clapet de tête du schnorchel était un clapet à boule, c'était donc la flottabilité positive de cette boule qui commandait la fermeture. Bien entendu, avec ce système, le clapet se fermait avec un certain retard soit par l'arrivée d'une vague, soit par perte d'immersion. Il en résultait une entrée d'eau quasi permanente durant la marche au schnorchel.
Le maître de central n'avait aucun contrôle du débit d'eau ni de la manœuvre de la coupole. Le mécanicien schnorchel avait donc pour tâche de hisser le tube d'air, d'ouvrir la coupole et le général d'échappement schnorchel, aidé par le cuisinier car la commande de cet échappement se trouvait dans la cuisine. Un dialogue s'installait entre Chef de quart diesel et cuisinier ou mécanicien schnorchel, et mécanicien schnorchel avec le maître de central. Il n'y avait aucune électrode de détection d'eau et, c'est le mécanicien qui annonçait « la purge donne de l'eau » ou « la purge donne beaucoup d'eau ».
Le maître de central, outre la surveillance de l'immersion, avait un œil par le panneau des auxiliaires pour voir si le niveau d'eau ne montait pas trop vite dans la cale ; Quand il voyait le mécanicien des auxiliaires avoir les pieds dans l'eau, il fallait alors songer à donner l'alerte ! Quand on sait que la batterie était fatiguée et qu'il fallait faire cinq à six d'heures de schnorchel par jour, le stress était permanent. Les ratés de lancement des diesels étaient nombreux, ainsi que le noyage des moteurs. Le poste équipage étant juste après le compartiment des diesels, nous étions les premiers à voir arriver un nuage de fumée noire en provenance des diesels, signe du raté. En trois ans d'affectation sur le Roland, j'ai vu une seule fois le compartiment des diesels rutilant, c'était à la sortie du carénage. Par la suite, la couleur vert clair du compartiment avait laissé place à la couleur de la suie.
 Sous-marin S613 ROLAND MORILLOT - 1962 : Le poste des mécaniciens et des électriciens
Sous-marin S613 ROLAND MORILLOT - 1962 : Le poste des mécaniciens et des électriciensLe pain
"Le pain se dégrade" Durant les périodes de navigation, il n'y avait pas de retour à quai le week-end, vu l'éloignement des secteurs. Aussi, les Casex Aéro se terminant assez tôt le vendredi après-midi, régulièrement par panne du radar de l'avion (à l'époque des P2V7 Neptune); Le PC OPS de la deuxième ESM organisait pour meubler ces deux jours, des SMX (détection sous marin contre sous marin) avec le copain du secteur à côté. Vu nos médiocres performances en matière de détection et de capacité des batteries, nous jouions le rôle du chassé, en nous baladant au schnorchel dans le secteur du copain, qui n'avait aucune difficulté à détecter notre arrivée en fanfare.
Les sous-marins de ce type n'avaient pas été conçus pour faire du tourisme et encore moins de la gastronomie. La cuisine était rudimentaire et il n'y avait aucun moyen de faire du pain. Le pain embarqué, malgré les traitements de conservation certifiés par la boulangerie des SAO, avait un drôle d'aspect au bout d'une semaine. La moisissure dite «noble» avait fait son apparition, et le triage des tranches de pain qui à la fin devenaient quelques morceaux de mies à peine mangeables, entamaient un peu le moral des troupes.
Ayant eu vent de notre pitance, le Narval qui était notre adversaire d'exercice ce week-end, avait eu la grande bonté de faire quelques fournées supplémentaires et se proposait d'organiser un ravitaillement. La météo étant relativement clémente, d'un commun accord les deux sous-marins font surface et viennent à quelques encablures l'un de l'autre. N'écoutant que sa vaillance, «Bigoudis» le bosco du Narval, figure emblématique de la deuxième ESM, ancien patron de LCVP en Indochine, malgré une houle inquiétante, prend place dans le dinghy, seul à bord, pour nous amener la précieuse fournée soigneusement emballée dans des sacs vinyles, prévus pour les poubelles.
Nous sommes trois à nous faire mouiller les pieds sur le pont pour réceptionner la précieuse cargaison. Vu la houle, nous lui passons un lance-amarre et établissons un va et vient. En retour, nous faisons parvenir au bosco quelques bonnes bouteilles que le carré du Roland avait eu soin de préparer à l'intention du Narval. «Bigoudis», visiblement peu satisfait du contenu un peu trop sophistiqué à son goût, interpelle la passerelle « Commandant, vous n'avez pas un coup de rouge de précision pour le bosco ? » Auquel le pacha s'exécuta de bonne grâce en faisant parvenir à notre godilleur émérite une bouteille de bordeaux. Ce fut un intermède qui égaya tout le monde, et le repas accompagné de pain frais releva le moral des troupes, jusqu'au retour à quai à la fin de la semaine.
La technique a heureusement bien évoluée depuis, mais l'état d'esprit des sous mariniers est resté le même. Et puis nous avions 20 ans et acceptions ces contraintes avec philosophie. C'est un peu pour la particularité d'emploi de ce vieux bateau, que nous y sommes restés si attachés.
 Sous-marin S613 ROLAND MORILLOT - 1963 : Bol d'air au large de Gibraltar (Espagne)
Sous-marin S613 ROLAND MORILLOT - 1963 : Bol d'air au large de Gibraltar (Espagne) Photo Christian Lecalard
Photo Christian LecalardSous-marin S613 ROLAND MORILLOT - 1963 - Un groupe de pirates à Gibraltar (Espagne)
 Sous-marin S613 ROLAND MORILLOT - 1963 : Baignade sous l'île de Groix
Sous-marin S613 ROLAND MORILLOT - 1963 : Baignade sous l'île de GroixÀ lire aussi :